Au début j’avais titré « l’agonie du IIIè Reich ». Mais cela aurait été faux : c’est bien l’Allemagne toute entière qui a payé pour quelques mois de résistance inutile et sanglante, au mépris de toute logique militaire.
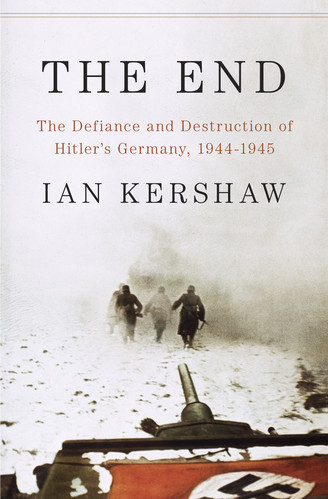
L’autodestruction
Ian Kershaw s’étonnait qu’il n’y ait pas de livre sur ces derniers mois de la guerre vus du côté allemand ; il l’a donc écrit, et il analyse les raisons de cette incompréhensible obstination allemande à laisser anéantir son pays par le double rouleau compresseur allié — pour rien.
Pourtant, dès l’été 1944, en tout cas au plus tard début janvier 1945 (après l’échec allemand dans les Ardennes et alors que les Soviétiques dévastent la Prusse Orientale) il aurait dû être clair que tout était perdu et qu’il valait mieux négocier une reddition. La stratégie de la lutte « fanatique » pied à pied ne pouvait mener à rien. La population était à bout de souffle, les réserves en hommes raclées jusqu’à l’absurde, l’économie étouffée (malgré les talents d’organisateurs de Speer), la Luftwaffe anéantie, les voies de communications en ruine, les villes rasées.
Les chiffres donnent le vertige : sur 18,2 millions de soldats allemands mobilisés en 1939-45, 5,3 millions sont morts, dont 2,6 millions après juillet 1944 — autant en dix mois que dans les quatre premières années de la guerre. Et parmi eux 1,5 million sur le front est : ils ne se sont donc pas défendu que contre les « bolcheviques ».
Mécanisme pour un suicide collectif
Dans les dernières semaines, 10 000 soldats tombaient chaque jour. Seuls les plus fanatiques croyaient encore aux « armes miracles » promises par Hitler, ou à l’éclatement de la coalition alliée. Alors pourquoi lutter ?
La réponse est complexe. Les dirigeants nazis étaient parfaitement au courant que les Alliés ne leur feraient aucun cadeau. Pour Hitler, les Allemands s’étaient montré faibles, ils devaient disparaître avec lui. Il est allé au bout de sa démentielle logique suicidaire, mais il a bien été le seul avec Goebbels. Mais Himmler, Bormann, Göring, Speer, les généraux, l’essentiel des Gauleiters (chefs de partis régionaux)... avaient bien l’intention de sauver leur peau, et ceux qui se sont plus tard suicidés allaient être fait prisonniers. Certains se voyaient un rôle dans l’Allemagne d’après-guerre (Speer), voire tentèrent très timidement de négocier dans le dos d’Hitler. La population, qui avait soutenu le nazisme durant une douzaine d’années, ne faisait plus confiance ni au Parti ni au Führer. Pourtant, pour bien moins, elle s’était soulevée en 1918, et cela valait aussi pour les soldats.
Pourtant, il a fallu attendre encore une semaine après la mort d’Hitler pour que son successeur l’amiral Dönitz jette l’éponge et signe la reddition sans condition face à toutes les armées alliées.
Dönitz, Guderian... : nombreux de généraux se peignirent dans leurs mémoires comme de simples exécutants apolitiques. Il est vrai qu’Hitler n’écoutait pas leurs conseils et refusait le moindre repli. Beaucoup rêvaient de sauver les meubles par une paix séparée avec les Occidentaux, mais ils exécutèrent ces ordres absurdes et menèrent le combat de leur mieux, sur les deux fronts et jusqu’à la fin. Von Stauffenberg, Rommel, von Tresckow ou Beck avaient pourtant montré que des officiers, eux-mêmes très nationalistes, étaient capables d’agir — hélas ils étaient l’exception.
L’attentat raté de juillet 1944 est une des clés. D’abord il a remonté la cote d’Hitler auprès des Allemands, vacillante depuis l’enlisement en Russie, bien que le Führer soit resté plus populaire que le Parti nazi. Puis il a conforté le dictateur dans son idée que la Wehrmacht était remplie de traîtres, responsables de tous les échecs. Ensuite, il entraîne la mise en place d’un régime de terreur, réprimant toute déviance, tout défaitisme, toute méfiance envers le Führer, tout doute envers la victoire future.
Le souvenir de l’insurrection de 1918 hantait Hitler. Il avait décidé qu’il n’y aurait pas de réédition de ce « coup de poignard dans le dos ». Ce régime de terreur ira donc crescendo, s’accentuant avec chaque revers : peine de mort pour les déserteurs, les couards, les défaitistes, pour tous ceux osant évoquer une possible négociation avec au moins les puissances occidentales, ou tentant d’éviter d’inutiles combats dans leur ville ; cours martiales volantes exécutant elles-mêmes les condamnations ; massacres de civils affichant des drapeaux blancs... Le Werwolf devait mener une guérilla dans les zones occupées, et punir les « collabos » (au final sans grand succès, mais il y eut tout de même quelques milliers de morts selon Kershaw).
Parallèlement la pression sur la population s’accentua : Goebbels parvint à dégager des centaines de milliers d’hommes à envoyer au front [1], quitte à désorganiser l’économie et les productions d’armement, au grand dam de Speer. Le Volkssturm enrôla des millions de vieux ou très jeunes Allemands dans une armée hétéroclite, mal habillée, très mal armée, sans efficacité militaire et au taux de perte terrible. Dans les zones proches du front, vieux, jeunes et femmes furent contraints de creuser des fossés qui n’ont pas stoppé l’Armée Rouge plus de quelques heures.
La bureaucratie civile laissa place à celle du Parti, omniprésente, sur fond d’affrontement larvé entre Speer et Goebbels, entre ceux qui pensaient à l’avenir et les partisans de la terre brûlée. Le Parti et les SS se mirent à dominer aussi sur le plan militaire (on confia une armée à Himmler, avec des résultats désastreux). On exigeait un sacrifice aveugle des soldats. Il y eut même des kamikazes nazis.
Ainsi la population se retrouva en tenaille entre un Parti punissant cruellement toute déviance ; des conditions de vie de plus en plus difficiles ; des exigences de service militaire ou paramilitaire démentielles ; la menace des bombardements alliés réduisant méthodiquement les villes en miettes ; à l’est la menace des Soviétiques. Les Allemands avaient perdu toute confiance en Hitler mais, épuisés, terrorisés, ils devinrent au mieux attentistes et fatalistes, priant pour que la fin arrive vite (Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende [2]) et les plus chanceux dans les zones préservées ne portent pas grande aide aux réfugiés de l’est.
Les soldats ne valaient souvent pas mieux. Également épuisés, tiraillés entre le danger des combats, la perspective des camps en Sibérie ou la liquidation pour couardise, inquiets pour leurs familles dans les villes bombardées ou les zones envahies par l’URSS, ils continuaient le combat — sans illusion pour la majorité. Sur le front de l’est, la conscience de défendre concrètement leur pays et leur famille d’un envahisseur barbare maintenait plus la combativité qu’à l’ouest. La terreur nazie, la menace sur les familles (Sippenhaft) mais aussi la cohésion avec les camarades limitaient les désertions, pourtant de plus en plus nombreuses au fur et à mesure de l’avancée alliée.
Les comportements varièrent suivant les fronts. À l’ouest, on craignait les bombardements anglo-américains sur les villes, mais les troupes d’occupation, relativement disciplinées, n’inspiraient pas la peur. Nombre de villes voulurent se rendre pour éviter la destruction : leur sort se joua dans le rapport de force entre notables voulant épargner vies et biens, et nazis jusqu’au-boutistes prêts à sacrifier une bourgade pour stopper les Américains une heure. (Au passage, une pique sur le comportement des Français : leurs troupes n’ont pas été exemplaires et ont commis leur lot de pillages et viols. Kershaw note qu’il y a une amplification possible du phénomène dans la mémoire et les sources : les soldats étaient souvent issus des colonies.)
C’était bien pire à l’est. Les soldats mesuraient parfaitement la barbarie du comportement allemand en Europe de l’Est, et se doutaient, puis surent, que les Russes allaient leur faire payer. La propagande soviétique attisait la haine. Les soldats allemands prisonniers savaient que, même avec de la chance, ils passeraient des années en Sibérie (et une bonne partie n’est pas revenue). Quant aux civils, ils fuyaient en masse pour éviter viols (généralisés), pillage, voire destruction de villes entières. La peur des « Asiatiques », amplifiée par la propagande de Goebbels, mena à des scènes de suicides collectifs dignes des Japonais à Okinawa. Pour les habitants de Prusse ou de Poméranie le salut n’existait que dans la fuite, au milieu d’un hiver terrible — les plus fragiles mourront souvent. [3]
Les chefs du Parti donnèrent cependant rarement l’exemple du sacrifice qu’ils prônaient. Les premiers à punir toute reculade, ils étaient aussi les premiers à fuir dès que possible, sans oublier leurs biens. À côté de Göring et d’Hans Franck, la palme revient peut-être à Erich Koch, à la tête la Prusse Orientale assiégée par les Russes : il refusa la moindre évacuation de civils, mais prit au tout dernier moment la fuite en bateau, en n’oubliant pas sa Mercedes.
Kershaw conclut que l’effarante résistance allemande tenait aussi bien à la structure du pouvoir nazi et à la terreur qu’aux rigidités de la mentalité des soldats allemands, sinon de tout l’appareil institutionnel. Si population et soldats étaient terrorisés et préoccupés par leur survie immédiate, les généraux risquaient bien moins (surtout d’être démis [4]). Si on peut comprendre que les circonstances ou le chaos rendaient un coup d’état impossible, pourquoi n’ont-ils pas au moins « levé le pied » ? Si les Russes et le communisme semblaient un danger tellement effroyable, pourquoi ne pas avoir ouvert le front à l’ouest pour sauver les meubles ? Le serment de fidélité au Führer, l’honneur militaire, toute une tradition militariste allemande d’ordre et d’obéissance inconditionnelle, leur interdisait de tenter quoi que ce soit contre la hiérarchie en place. Après tout, même Canaris avait renoncé à s’attaquer à Hitler. Ce n’est qu’à la mort d’Hitler que Dönitz (paradoxalement choisi par Hitler pour sa fidélité au national-socialisme) s’est senti autorisé à tenter une négociation puis à signer.
Pendant ce temps, l’administration continuait tant bien que mal de fonctionner, elle ne s’effondra pas brutalement. Les fonctionnaires considéraient que cela était leur « devoir », même dans des conditions difficiles, prolongeant ainsi la guerre et les destructions de plusieurs semaines.
Et si...
À la lumière de ce mécanisme Kershaw spécule : si Hitler était mort en juillet 1944, les conjurés auraient-ils pu réellement prendre le pouvoir ? Et s’ils avaient accepté la reddition sans condition, les SS auraient-ils suivi, dès 1944, surtout à l’est ? Une nouvelle légende du « coup de poignard dans le dos » serait née.
Pour Kershaw, l’exigence alliée d’une reddition sans condition n’a pas joué fondamentalement dans la prolongation de la guerre. Elle a souvent été présentée comme contre-productive car ne laissant aucune alternative aux Allemands que la lutte jusqu’au bout. Elle n’a cependant pas empêché la tentative de putsch de juillet 1944. C’est Hitler, relayé par son Parti, qui bloquait toute tentative de reddition, pas les généraux, même si ceux-ci obéissaient. En Italie, Kesselring n’a accepté la reddition de ses troupes qu’après le suicide du Führer. Et si la perspective de livrer des millions de soldats à l’Armée Rouge effrayait tout le monde, même Dönitz s’y est résolu quand Eisenhower a clairement dit qu’il n’y aurait pas d’alternative.
Les victimes et les lâches
Ian Kershaw parle aussi de Dresde, qui se croyait protégée par sa valeur architecturale, mais était aussi une cible car nœud de communications et centre industriel. Il y eut pourtant pire, en nombre de victimes (Hambourg) ou en proportion (Pforzheim).
En parallèle, Kershaw rapporte aussi le calvaire des prisonniers des camps de concentration, décimés dans des marches forcées en plein hiver, où beaucoup, sinon la plupart, trouvèrent la mort, et cela sans plus guère la moindre justification rationnelle pendant les derniers mois (ni otages ni force de travail). Apparemment ils n’obtinrent pas d’aide de la population, toujours abrutie de propagande.
Après la guerre
L’ampleur des pertes humaines et des destructions, le calvaire des réfugiés de l’est et la haine du Parti dans les derniers mois poussèrent plus tard les Allemands à se voir aussi comme des victimes du nazisme. Ce n’est pas complètement faux, pourtant ils l’avaient soutenu pendant des années malgré tous ses crimes. Certes une manière de se dédouaner lors de la dénazification, mais une réaction normale : le traumatisme a éclipsé dans l’inconscient tout ce qui l’a précédé. Le travail de mémoire a pris des années.
Remarques personnelles
On peut écrire des uchronies sur une fin de guerre différente. L’Allemagne actuelle est née de ce traumatisme : serait-elle devenue si démocratique et pacifique sans le cataclysme de 1945 ?
À la lecture des ordres hallucinants de cruauté et de mépris pour la population ou les soldats, on enrage que certains grands chefs s’en soient tirés : si Keitel a été pendu [5], bien des généraux qui ont suivi Hitler jusqu’au bout n’ont même pas été condamné à perpétuité par la suite : Dönitz, Schörner, Kesselring... alors qu’ils ont jusqu’au bout fait appliquer les ordres délirants et surtout la politique de terreur.
Quant à la forme du livre : rien à redire sur le texte, il est clair. La division en chapitre est chronologique, mais chacun traite successivement tous les thèmes. La masse de références à des travaux précédents est impressionnante. Hélas les notes sont en renvoi en fin de livre, et non en bas de page, ce qui est pénible. Or certaines sont très intéressantes et valent d’être lues.
Les termes sont tous traduits, il n’y a quasiment aucun texte en allemand, dommage pour les germanistes qui auraient préféré la version originale des citations.
La version française s’appelle logiquement La Fin.
Notes
[1] J’ai connu un Allemand, lycéen à l’époque, qui a eu le choix entre s’engager volontairement dans la Wehrmacht, ou finir d’office dans les Waffen SS.
[2] Plutôt une fin dans l’horreur qu’une horreur sans fin.
[3] Rappelons que le quart est du Reich devint polonais par la volonté de Staline : la frontière entre Germains et Slaves est donc revenue à la même position qu’en l’An Mil !
[4] Pourtant Kershaw donne lui-même l’exemple d’un général dont la famille fut emprisonnée car il avait reculé sans autorisation. Et la famille de von Stauffenberg a fini en camp de concentration. Les étoiles ne protégeaient donc pas du pire.
[5] Pas fusillé comme tout militaire, mais bien pendu.



2 réactions
1 De FrédéricLN - 25/07/2013, 16:52
Dans ses mémoires, Dönitz explique ses 8 jours de guerre après le suicide d'Hitler : la consigne donnée aux troupes était de faciliter la fuite des civils vers l'Ouest pour éviter qu'ils ne se retrouvent dans la zone soviétique. Il essayait donc, mais en vain, d'obtenir un cessez-le-feu séparé sur le front Ouest. Cela ne justifie évidemment pas son comportement pendant le reste de la guerre (dont je ne me souviens pas s'il est estimable ou condamnable).
2 De Le webmestre - 25/07/2013, 22:50
@FrédéricLN : Oui, Kershaw en parle. Dönitz a essayé de gagner du temps (pendant lequel des gens se sont fait tuer) pour sauver son armée des griffes des Russes. Vu le taux de pertes en Sibérie, ça se comprenait.
C’est encore une démarche rationnelle. Ce qui ne l’est pas c’est Hitler qui ne tente même pas ça (mais il était fou), et TOUTE la hiérarchie militaire qui suit aveuglément tant qu’il est vivant.
Eisenhower n’a pas voulu négocier quoi que ce soit. Dönitz a bien fait de la taule pour crimes de guerre (mais pourquoi pas perpètte comme tout criminel à grande échelle ?).