Le contexte historique est peu connu des Français : au XVIIᵉ siècle, le Portugal sous domination espagnole, sous l’influence de catholiques parmi les plus sectaires (dans une époque déjà pas très tolérante) chasse ses Juifs. Ceux-ci se réfugient aux Pays-Bas, nation la plus libérale d’Europe, économiquement et religieusement (catholiques et différentes formes de protestantisme se tolérant à peu près). Sans oublier leur patrie, ces Juifs prospèrent dans le commerce, et s’intègrent dans une certaine mesure. Parmi eux naît Baruch Spinoza.
La coexistence pacifique entre Juifs et Néerlandais, protestants ou catholiques, ne signifie pas ouverture, et être minoritaire ne signifie pas être tolérant. Les rabbins ne sont pas mieux que l’Église, et trop dévier des croyances de base mène à l’anathème : c’est le sort d’Uriel da Costa qui ouvre le livre, ce sera celui de Spinoza, qui a repris ses idées. Les Juifs ne peuvent brûler leurs hérétiques, mais ils peuvent les bannir de leur communauté : même la famille ne doit plus voir le coupable. Un symptôme flagrant de sectarisme. Les protestants emprisonnent et laissent mourir, ce sera le sort d’amis de Spinoza.
Autre hypocrisie de l’époque : s’ils avaient publié en latin, que le bas peuple ne comprend pas, ils auraient eu beaucoup moins de problèmes.
Spinoza est d’abord repéré comme un futur grand rabbin. Sa connaissance de la Bible hébraïque lui permet de discuter avec des exégètes néerlandais (le dialogue interreligieux étant déjà une dangereuse nouveauté), puis d’accéder aux auteurs contemporains disponibles en latin : Descartes, Hobbes… Spinoza est d’abord cartésien, puis prolonge le raisonnement. En relisant la Bible et en s’appuyant uniquement sur la raison, il constate qu’elle n’a plus de cohérence, sauf à prendre absolument tout au figuré. En conséquence, plus aucun dogme chrétien ou juif n’est sûr. Spinoza ne va pas jusqu’à l’athéisme, pour lui Dieu est la nature. Mais tout le reste est renvoyé à la superstition, de l’immortalité de l’âme au libre arbitre, de la téléologie aux commandements, et la réaction des religieux est violente, très violente.
Même aux Pays-Bas, l’époque n’est pas pacifique. Non seulement De Witt perd le pouvoir, à cause de revers militaires contre la France de Louis XIV, mais il finit lynché. Spinoza perd son protecteur.
Spinoza a pu survivre en vendant polissant des lentilles renommées, et éviter la prison en faisant autant profil bas que possible sans renoncer à la moindre de ses idées, et tant pis pour ses amours, mais sa santé fragile a raison de lui peu après. Ses amis et élèves réussiront à sauver et répandre ses idées iconoclastes parmi les philosophes. Ce n’était que le but de Spinoza. Ses lecteurs allumeront les Lumières au siècle suivant.
Page de l’éditeur : https://www.hc-editions.com/livres/spinoza/

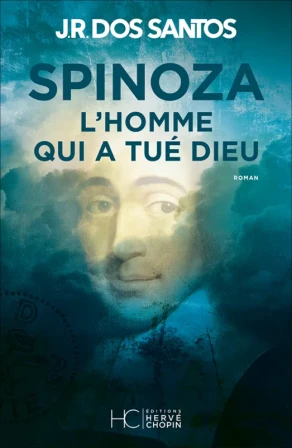



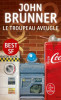

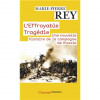


Derniers commentaires